La reconnaissance du harcèlement moral institutionnel par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 21 janvier 2025 n° 22-87.145
1/ Contexte de l'affaire
Dans le cadre de la privatisation de France Télécom (devenue Orange), l’entreprise a engagé à partir de 2006 des plans de restructuration visant à supprimer 22 000 postes et à imposer la mobilité à 10 000 agents. Ces transformations ont été accompagnées, entre 2007 et 2009, d’une vague de suicides et de tentatives de suicide de salariés.
Les anciens dirigeants de l’entreprise, soupçonnés d’avoir mis en œuvre une politique managériale visant à déstabiliser les salariés afin de provoquer des départs, avaient été condamnés en première instance et en appel pour harcèlement moral institutionnel.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'Appel
La Cour d’appel de Paris avait jugé que ces pratiques entraient dans le champ de l’article 222-33-2 du Code pénal, qui sanctionne les agissements répétés ayant pour objet ou effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé ou de compromettre leur avenir professionnel.
Les dirigeants condamnés ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que le harcèlement moral institutionnel ne correspondait pas à la définition légale, laquelle serait limitée à des faits visant des salariés individuellement identifiables.
La Cour de cassation
La chambre criminelle de la Cour de cassation, a rejeté cet argument.
Elle a jugé que « constituent des agissements pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés, aux fins de réduire les effectifs ou d’atteindre tout autre objectif managérial, économique ou financier ».
3/ La conclusion
La Cour de cassation rejette le pourvoi des dirigeants.
En consacrant la reconnaissance du harcèlement moral institutionnel, la Cour de cassation reconnait que la responsabilité pénale des dirigeants peut être retenue en raison de la mise en œuvre d’une politique d’entreprise qui, bien que collective, porte atteinte aux droits, à la dignité, et à la santé des salariés.
Des questions ? Notre équipe juridique se tient à votre disposition !
Zest' Avocats vous recommande :

L’accord de performance collective
L’accord de performance collective (APC) permet aux entreprises d’adapter leur organisation aux évolutions du marché.
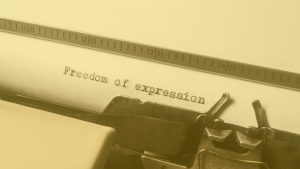
Liberté d’expression des salariés : méthode d’appréciation des sanctions disciplinaires précisée par la Haute juridiction
La Cour de cassation a précisé les contours de la liberté d’expression du salarié et la méthode d’appréciation des atteintes éventuellement portées à cette liberté par la notification de sanctions disciplinaires.

Prise en compte des congés payés dans le calcul des heures supplémentaires
Un salarié, dont le temps de travail était décompté sur une période de deux semaines, a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires.

Le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mise à disposition des listes d’émargement dans un contentieux en annulation des élections du CSE.
Le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mise à disposition des listes d’émargement dans un contentieux en annulation des élections du CSE.
